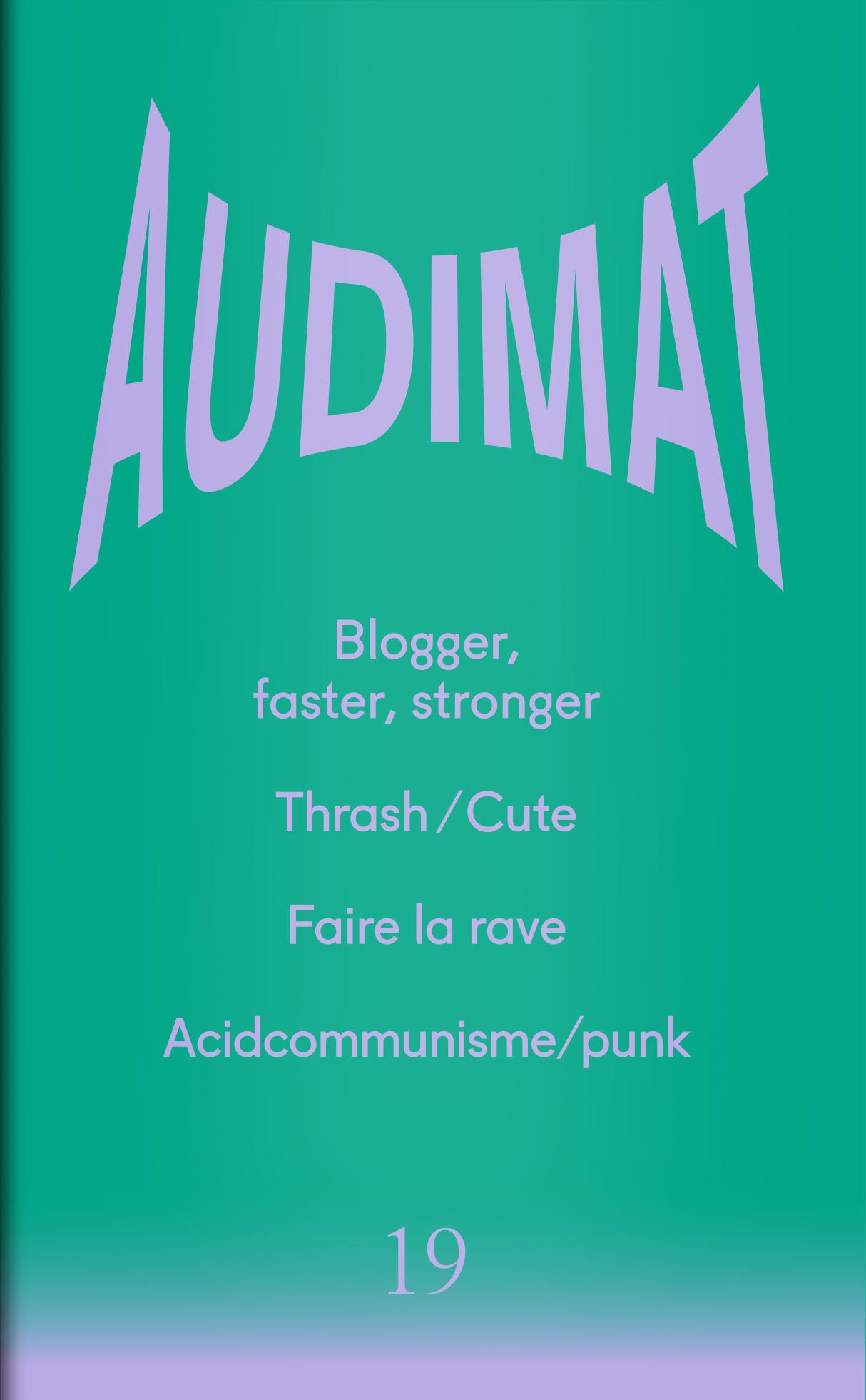Partie 2 : Enquêter pour transformer.
Comment sortir du marasme ?
J’ai montré dans une première partie l’inadaptation, les dangers et les fondements idéologiques de l’écologie managériale qui imprègne fortement les milieux professionnels de la culture et de la musique. Dans cette seconde partie, je voudrais esquisser quelques pistes afin d’engager une profonde transformation écologique de la musique. Pour ce faire, je me concentrerai sur le secteur des « musiques actuelles », la galaxie de structures et d’activités dédiées aux musiques populaires bénéficiant, à des degrés divers, de fonds publics.
Un vaste système connecté
Dans le secteur « musiques actuelles » français, on retrouve très largement les composantes de ce que les anglophones appellent l’industrie musicale et qui composent Music Declares Emergency. À savoir, des salles de concert réparties sur tout le territoire français avec des jauges variables (petits lieux associatifs et/ou municipaux, club parisiens, SMAC[1] mais aussi grandes salles type La Cigale, Zenith(s) etc.), des multitudes de festivals dont certains accueillent plusieurs centaines de milliers de personnes, des entreprises de production, de communication et de graphisme (qui peuvent travailler pour d’autres secteurs), de booking[2], de fournitures de matériel scéniques, vendeurs, réparateurs et importateurs d’instruments et d’équipements sonores, entreprises de billetterie, de transport de matériel et d’artistes, des sociétés de restauration. Qui dit musique dit également musique enregistrée et filmée, labels de disques (de toutes tailles et reliés à d’autres industries culturelles pour les plus gros), studios d’enregistrement et de production audiovisuelle, équipements spécifiques (logiciels, ordinateurs, amplification, traitement sonore, caméras), sites Web (artistes, labels, entreprises de production, fans, vendeurs d’instruments) et réseaux sociaux de tous les protagonistes. Sans oublier les médias (spécialisés et généralistes), la presse papier, les institutions publiques, les organisations professionnelles (syndicats, réseaux territoriaux), les événements organisés par la profession, etc. Des écoles et associations enseignent ces vocabulaires, des lois et des contrats régissent certains de ces échanges. Toutes ces activités et dispositifs sont étudiés par des académiques, donnent lieu à des recherches, des rapports, des ouvrages, des articles, des colloques professionnels, commentés et relayés par des médias. Dans cette galaxie connectée de nombreuses personnes et collectifs s’activent : administratifs, technicien.nes (roadies, web masters, community managers, éclairagistes etc.), artistes solo ou en groupe, enseignant. e. s, programmatrices/teurs, responsables et employé.es des institutions publiques, journalistes, attaché. e. s de presse et de médiation dans les salles, etc. Toutes ces activités — live, enregistrées et/ou en ligne — engagent et rassemblent des publics. Selon les styles musicaux et les structures, les compétences, les outils, les prestataires et les connexions avec d’autres structures équivalentes, avec d’autres pays, avec d’autres activités (par exemple la restauration ou la sécurité pour un gros festival) peuvent grandement varier.
Je l’ai déjà évoqué, ce réseau comprend des structures et des événements de très grande taille (par exemple certains des festivals cités au début de ce texte) mais aussi de très moyennes et petites (voire micro) structures. D’innombrables « transformateurs » connectent ces protagonistes : un financeur territorial, un fournisseur de scènes et de connexion au réseau électrique, une société de booking, des technicien. n.e. s, des artistes et des véhicules qui circulent, etc. Quand on analyse les « musiques actuelles » de cette manière, on réalise que ce sont les innombrables connexions entre des petites, moyennes ou grandes composantes qui en font un grand système. Pour le dire autrement, cinquante tournées simultanées de petits groupes ne sont pas nécessairement moins toxiques du point de vue socio-environnemental qu’un méga concert de U2 dans un stade. C’est un point essentiel, l’interconnexion entre tous les protagonistes des musiques actuelles est au moins aussi importante que la taille de chaque unité.
Une activité qui alimente et dépend d’autres infrastructures
Quelles que soient ses spécificités, le monde des « musiques actuelles » ne peut fonctionner sans des infrastructures externes. Il utilise les grands réseaux de transport (pensons aux centaines de tour-bus qui vont d’une salle de concert à l’autre, aux autoroutes et aux aéroports utilisés), d’innombrables canaux de communication, (en particulier le web), beaucoup d’énergie (le gasoil des tour-bus, l’électricité des sonorisations et des bâtiments) et des ressources naturelles (la nourriture des festivaliers, l’eau pour fabriquer les costumes, les minerais pour les composants des consoles de mixage, etc.). Il dépend également de la monnaie et des institutions privées et publiques qui contribuent à son financement. Comme on l’a vu plus haut, toutes ces infrastructures externes utilisent des outils numériques, des centres logistiques, dépensent de l’énergie, emploient (et exploitent) des personnes, impliquent des circulations, construisent et occupent toutes sortes de bâtiments, etc. En s’inspirant du concept d’infrastructures réciproques de Jane Hutton, on pourrait dire qu’au vaste écheveau « musiques actuelles » correspond un vaste territoire d’externalités négatives ; maltraitance de nombreux individus et collectifs humains, extractions de ressources particulières (les métaux pour les appareils électroniques) et énergétiques, déforestations, dépenses d’eau, pollutions plastiques et chimiques, accumulation de déchets et ce qui en résulte : chute de la biodiversité, extinction accélérée des espèces, disparition des milieux humides, contamination des milieux, explosion des cancers et des pandémies, migrations climatiques[3].
À la manière des grands réseaux électriques interconnectés et très largement gérés par des intérêts privés, la logique intrinsèque des « musiques actuelles » est de toujours croitre. Cette dynamique d’extension propre aux grands réseaux est renforcée par l’appétit de nouveauté qui caractérise les activités artistiques. Ce besoin et ce goût de renouvellement perpétuel sont en effet au cœur de la cosmogonie moderne. Sans répit, les mondes artistiques programment de nouvelles choses, de nouveaux dispositifs, dénichent et promeuvent des « émergents », des nouveaux styles, de nouveaux formats, de nouveaux génies. Si on rend souvent hommage à celles et ceux qui durent, on critique souvent avec férocité ce(ux) qui ne se renouvelle(nt) pas assez. À la façon de la programmation des spectacles (que l’on naturalise sous le terme de « saisons » dans le monde théâtral), le monde musical professionnel lessive (presque tout) et tout le temps, on pourrait parler de musical washing. Dans cette forme spécifique d’obsolescence programmée, ce sont les œuvres et les équipes artistiques (au sens de tous ceux et celles qui concourent à une œuvre) qui sont rapidement démodées et mises au rebut. Soutenue par une histoire de l’art peuplée de génies mâles blancs, cette course effrénée à la nouveauté va bien au-delà des mondes musicaux et artistiques. Elle crédibilise l’idée et la nécessité (modernes) du progrès et du renouvellement constant des biens et des personnes. Si des dispositifs (para) publics soutiennent certaines équipes artistiques (subventions, régime de l’intermittence, accueil pour des créations) et des structures, la logique de sélection du marché s’impose très largement dans ces mondes. La compétition et l’idéologie méritocratique sont très vivaces : l’idée que certain·es réussissent et d’autres pas, qui serait par exemple jugée intolérable en matière d’éducation, est acceptée, souvent justifiée, et très largement intériorisée dans un monde qui bénéficie pourtant de subventions. La grande majorité des artistes, technicien·nes et administratif·ves sont des précaires dépendant·es du bon vouloir des organisations qui les emploient et des programmateur·ices qui les choisissent ou les éliminent[4]. La récente paralysie des réseaux artistiques et des infrastructures au plus fort de la crise du covid a mis en évidence cette fragilité des précaires. Enfin, le monde des musiques actuelles est dominé par des hommes et peu ouvert aux minorités visibles tant sur les scènes, les enregistrements que dans les bureaux et les cabines techniques[5]. Concentré principalement sur la production de valeur artistique, le monde des « musiques actuelles » a jusqu’à récemment été assez indifférent à ce qu’il puisait dans la Terre et à toutes les précarités qui soutiennent son fonctionnement. Son recours aux infrastructures externes mondialisées, ce que l’anthropologue Mario Blaser appelle des infrastructures de déplacement , soutient leur croissance sans fin et augmente sa dépendance. Ce que les professionnels, experts et institutions publiques appellent « musiques actuelles » est donc un vaste système d’interdépendance technique, logistique et social, qui porte la croissance et la concurrence en son principe. Dans ces conditions, comment imaginer une transformation écologique (au sens de systémique) de ces mondes ?
Enquêter !
A/ Externalités négatives
En 2006, le regretté Bruno Latour a publié un livre intitulé Changer de société. Refaire de la sociologie[7]. Il y faisait l’éloge d’un philosophe (pragmatiste) étasunien du début du 20e siècle, James Dewey. Selon ce dernier, les problèmes publics, c’est-à-dire les problèmes qui concernent l’intérêt commun, ne peuvent pas uniquement être réglés avec les seuls outils de la démocratie parlementaire[8]. Pour faire face à des situations inédites et compte tenu de la complexité des organisations, des enquêtes permettent de mieux appréhender les tenants et les aboutissants d’un problème, de débattre de différentes options puis enfin d’agir. Pourquoi ne pas procéder ainsi en matière de « musiques actuelles » ? Plutôt que d’adopter des méthodologies et des conceptions managériales — dont on a vu les limites et l’échec patent —, pourquoi ne pas enquêter sur les différentes composantes des « musiques actuelles », ses infrastructures spécifiques, celles qu’elles utilisent (les transports, les communications, l’électricité, etc.), les logistiques qui lui sont nécessaires, les diverses circulations (de données, de personnes, de matériaux), les énergies consommées, ses bâtiments, les règles qui les concernent (par exemple les droits d’auteur), les formes d’emplois, d’organisation du travail, de précarités, de maintenance, etc. ? Ce premier inventaire viserait à documenter les différentes externalités négatives socio-environnementales de ce monde, telles que je les ai détaillées plus haut. Dans la lignée des ecological economics, il s’agirait non seulement de prendre en compte toutes les externalités environnementales des activités musicales mais aussi les discriminations, les exploitations sociales et les relations entre ces différents éléments.
B/ Des internalités positives
Pour appréhender d’une façon holistique cette galaxie, il faudrait aussi prendre en compte les expériences positives qui s’y déroulent, ce que l’on pourrait appeler ses internalités positives. Dans plusieurs travaux, Joëlle Le Marec a mené des enquêtes sur le (souci du) public dans les musées et les bibliothèques[9]. À chaque fois, elle s’est non seulement attachée à saisir la nature de l’expérience des usagers mais aussi comment les pratiques qui s’y déroulent constituent des biens communs et des formes spécifiques de savoir. Dans un récent livre sur les bibliothèques (publiques), elle montre par exemple que cet espace est en grande partie dédié au soin (au care)[10]: soin pour les usagers que l’on accueille et que l’on oriente pour accéder à des documents, respect pour ceux et celles qui déambulent entre les rayonnages, consultent un journal, un ouvrage, accèdent à l’internet ou viennent chercher un peu de chaleur ou de fraicheur selon les saisons. Soin aussi pour les documents que les bibliothécaires chérissent et entretiennent et que l’on consulte ou emprunte, sans pour autant en être propriétaire. Tact et attention entre les usagers et les bibliothécaires qui respectent le silence et la concentration dans les salles de lectures. Toutes ces formes discrètes, mais essentielles d’attention et de soin pour les personnes et les choses sont sans aucun doute également présentes dans les « musiques actuelles ». Pour ce qui concerne les usagers, on pourrait évoquer les sociabilités dans les différents espaces des festivals, les retrouvailles entre habitué·es (et responsables) dans les salles de spectacles, l’émerveillement de découvrir des artistes lors des concerts, les salles de répétitions où des formations amateurs jouent ensemble, les années d’enchantement durant l’écoute de musique enregistrée, de visionnage de vidéos en ligne, les forums de discussion en ligne et d’échanges de musique, etc. On pourrait également lister tous les échanges formels et informels entre les animateur·ices des lieux, labels et sites web et les usagers, l’activité des technicien·nes, l’entretien et la maintenance des lieux et des réseaux électroniques par des milliers de petites mains[11]. Tout ce travail attentionné, qui fait tenir ces mondes artistiques, et les innombrables formes de plaisir et de savoirs pratiques forgés par les usagers constituent certainement une partie essentielle des « musiques actuelles ». De plus, prendre en compte cette dimension est important si l’on veut contrer les approches néo-libérales. En effet, la dénonciation de l’incapacité des dispositifs publics à remplir leurs missions, par exemple à assurer une « démocratisation culturelle » (un concept par ailleurs fort discutable) a été instrumentalisée par les néolibéraux. Sous couvert d’améliorer les services rendus au public, on promeut des méthodes managériales au détriment des salarié·es et on privatise les structures culturelles et les services publics. Une route par exemple suivie dans nombre de musées où l’on a recouru à plus soif aux méthodes du marketing et du merchandising et ouvert la porte à des fondations financées par des transnationales[12]. L’exemple du Louvre, sponsorisé par Total Énergies, et exportant sa marque dans les monarchies pétrolières illustre cette dérive[13].
En prêtant attention au care, au plaisir, aux sociabilités, il me semble que l’on sort aussi quelque peu d’une posture consistant essentiellement à pourfendre. Au lieu de documenter seulement la toxicité d’un monde, on s’efforce aussi de rendre compte de tout ce qui le rend attachant pour ceux et celles qui s’y meuvent, à tout ce qui le rend (un service) public.
Savoirs de la précarité
Pour procéder à une telle enquête, on devrait également prêter attention ce que Joëlle Le Marec et Hester du Plessis appellent les savoirs de la précarité ou Donna Haraway les savoirs situés[14]. Ces autrices montrent en effet que l’expérience des personnes et des collectifs précaires (de diverses manières) permet d’apprécier sous une perspective différente les situations et les problématiques. Le mouvement des Gilets Jaunes a par exemple montré que dans les territoires (urbains, périurbains ou ruraux) où les services publics (écoles, postes, administrations, services de santé, équipements culturels, etc.) ont disparu, se déplacer en voiture procède moins d’un choix que d’une contrainte. En appliquant uniformément une taxe carbone à tous les usagers, on procède comme si l’utilisateur de SUV en centre-ville et l’habitant·e d’une zone paupérisée avaient les mêmes responsabilités. En montrant l’importance de la justice environnementale, les Gilets Jaunes ont montré que les questions environnementales étaient toujours des questions sociales, qu’elles étaient liées et qu’il fallait les traiter de concert. Le mouvement des Gilets Jaunes ou le récent travail de la convention citoyenne pour le climat illustrent l’intérêt d’impliquer les profanes dans les débats publics. Placée à un autre endroit que les expert·es et les professionnel·les, mobilisant sa propre expérience, l’expertise profane permet d’élargir la compréhension des problèmes et d’établir des consensus orientés vers le bien commun.
L’autre leçon du mouvement des Gilets Jaunes, et qui n’est pas moindre, c’est que les questions environnementales peuvent être traitées de façons non directement environnementales. Pour éviter que les personnes utilisent leur véhicule individuel, on peut rouvrir des lignes de train fermées pour cause de rentabilité insuffisante, financer des épiceries coopératives au lieu d’installer des hypermarchés dans des zones décentrées, arrêter de fermer des écoles et les autres services publics (postes, impôts, etc.), etc. En d’autres mots, des politiques publiques orientées vers l’intérêt général peuvent donc améliorer la vie des communautés et dans un même mouvement concourir à la réduction des gaz à effets de serre. Ce qui est vrai pour la voiture individuelle l’est aussi pour les tournées en tour bus (la quasi-norme dans les milieux rock) ; plutôt que de réduire la consommation d’essence des tour bus, d’acquérir des véhicules électriques (très couteux et générateurs de nombreuses pollutions et exploitations), il serait sans doute plus efficace de convaincre l’état et les régions d’aménager les trains. Aborder la décarbonation des musiques actuelles à partir des infrastructures permettrait sans nul doute d’établir des alliances avec d’autres protagonistes et de faire rimer son intérêt avec le bien commun. Pour enquêter sur les « musiques actuelles », il faudrait non seulement documenter différentes formes de précarités et d’exclusion, mais aussi recueillir avec attention le point de vue des personnes et collectifs précaires et précarisés par les « musiques actuelles ».
Culture et connexions
Avant de conclure, il faut s’arrêter un instant sur nature spécifique de la sphère culturelle et musicale. Comme on l’a vu à plusieurs reprises, un monde qui multiplie à l’infini les connexions et les circulations va à sa perte et nourrit des infrastructures toxiques et de plus en plus privatisées. Le capitalisme n’est pas seulement basé sur le fait d’extraire de la valeur à partir du travail salarié, il ne consiste pas seulement à utiliser la Terre comme une ressource (bon marché), à coloniser des territoires pour en enrichir d’autres[15] mais aussi à tout délocaliser[16]. Ce mouvement s’est considérablement amplifié avec la dernière globalisation qui a rendu encore plus opaque la provenance et la circulation des choses, les façons dont elles sont fabriquées, par qui et dans quelles conditions et les prédations. La complexité et l’enchevêtrement des chaînes de valeur et des réseaux logistiques rendent extrêmement difficile de savoir quels réseaux, quelles infrastructures, quelles mobilités, quels matériaux, quelles précarités sont impliqués pour une activité donnée. Cette difficulté à décomposer l’activité et conséquemment à la transformer pour qu’elle soit soutenable est dans la nature même du système actuel. Pour nombre d’analystes et de mouvements écologistes, il faut détricoter cette multiplication des connexions et relocaliser les échanges, accroître et consolider l’autonomie des personnes et des individus. Là où les choses se compliquent fortement, c’est que la production et la consommation culturelles ne peuvent pas être considérées et « traitées » de la même manière que l’alimentation, l’énergie, les matériaux de construction, les ressources naturelles, en bref les terrains habituels des écologistes[17]. En effet, toute culture — au sens anthropologique ou d’une forme artistique — est fondamentalement mobile et connexionniste. Elle résulte de liens entre des personnes et des collectifs (plus ou moins) éloignés — dans l’espace ou dans le temps. Toute culture est également un composé d’autres cultures, un hybride qui, quelles que soient ses apparences, ne peut être réduit à du « strictement local » : même le lieu apparemment le plus isolé est, lui aussi, un composé de plusieurs « localités ». Lorsque l’on observe la provenance des végétaux décrits comme indigènes dans n’importe quelle région du monde, on ne tarde pas à s’apercevoir que la plupart viennent d’ailleurs. En d’autres mots, et comme le rappellent les mélanges que l’on retrouve dans les étiquettes stylistiques (hardcore pop, grunge folk etc.), les productions culturelles (et musicales) sont issues d’hybridations et de mélanges. En d’autres mots, la connectivité et la circulation sont des composantes génériques de la culture, de l’art, de la musique et peuvent même être considérées comme des internalités positives. Même avant les (technologies, les médias et réseaux) modernes, la connexion, les migrations, les circulations étaient consubstantielles à l’humanité et à la vie[18].
Alors comment faire pour rendre les biens et les échanges culturels soutenables et sans prédations sociales ? Comment réorienter radicalement les activités artistiques ? Comment les déconnecter des infrastructures externes ? Comment se départir des ravages de la modernité sans renoncer à être modernes ? Et dans une telle perspective, comment décider ce qui devrait être conservé et ce qui devrait disparaître ? Comment apprécier les besoins essentiels des factices, se déconnecter en restant… connecté·es ? Pour éviter les modes autoritaires et/ou technicistes, la réponse est sans aucun doute de développer des outils de délibération et de prendre en compte les plus vulnérables. Dans ce cadre, le recours à des enquêtes, conçues et menées de concert par des chercheur·es, des professionnel·les, des élu·es et des usager·es et des débats démocratiques peuvent là encore aider à apprécier et définir le type et le nombre de connexions dont un monde social a besoin et leur soutenabilité.
Où réaliser des enquêtes et qui pour les mener ?
Tout cela étant posé, où et comment mettre en œuvre une enquête qui s’intéresserait tout à la fois aux différentes formes de prédations et de discriminations, aux pratiques d’attention et de soin, aux différents types de savoirs et d’expériences propres à ces mondes et aux différentes infrastructures mobilisées ? Plusieurs options sont possibles.
On pourrait s’intéresser à un territoire donné (une métropole, une région par exemple) ou bien à un secteur spécifique (les festivals de musique électronique, le monde des tourneurs) ou bien articuler dimension territoriale et stylistique (les musiques techno en Bretagne) ou bien encore comparer deux secteurs situés dans un même territoire. Le choix des territoires, des lieux et dispositifs à étudier et les façons de mener (et de représenter) cette recherche pourraient être définis par un groupe composé d’académiques, de professionnel·les, d’élu·es, de représentant· es d’ONG environnementales, d’associations de consommateur·ices, d’amateur·ices / profanes, des structures qui financeraient le projet de recherche et d’activistes, associations ou structures ayant déjà menées des actions et des réflexions dans le territoire choisi. Dans ce cadre, il serait fondamental que tant lors de la phase de conception de l’enquête que sa réalisation, des collectifs, des structures, des groupements, des personnes déjà engagées dans des pratiques écologiques, non discriminatoires, queer, à visée sociale (et tous les hybrides entre ces entrées), dans l’organisation d’événements professionnels ou pas (par exemple des raves) au sein des territoires et des styles investigués soient associés à l’enquête[19]. Procédant ainsi, on pourrait prendre en compte l’expérience de celles et ceux qui ont, en quelque sorte, déjà mené des enquêtes et expérimentent des pratiques soutenables. Une fois l’enquête menée, les conclusions à tirer et les décisions à prendre pourraient être discutées par une convention citoyenne, composée de façon hybride. Celle-ci pourrait alors formuler des recommandations visant à mettre en œuvre une transformation socio-environnementale dans ce secteur[20]. Dans cette configuration (il y en a certainement d’autres), il serait important que les conditions de la mise en œuvre des recommandations de cette convention soient précisées et garanties dès le début du processus.
Un tel dispositif est-il si compliqué à mettre en œuvre ? Eh bien, si une convention citoyenne, réunissant des personnes de tous horizons, a été capable d’établir un diagnostic et de définir un agenda pour sortir des énergies fossiles, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire en matière de musiques populaires et de politiques publiques culturelles ? Pourquoi l’un des territoires les plus imaginatifs et foisonnants, la musique, ne pourrait-il pas déployer ses ressources pour ré-imaginer son avenir ?
[1] SMAC = Scènes de Musiques Actuelles, label attribué par le Ministère de la Culture.
[2] Mise en relation entre un.e artiste et un.e programmateur.trice.
[3] Murray Bookchin. Our Synthetic Environment. Harper & Row,1975 ; Matthieu Duperrex Voyages en sol incertain. Wild Project, 2019 ; Nathaniel Rich. Second Nature, Straus and Giroux, 2021.
[4] Catherine Dutheil-Pessin et François Ribac. La Fabrique de la programmation culturelle, La Dispute, 2017.
[5] Voir par exemple L’état des lieux sur la présence des femmes dans la filière musicale (février 2023) https://cnm.fr/letat-des-lieux-sur-la-presence-des-femmes-dans-la-filiere-musicale/
[6] Conférence de Mario Blaser au Musée d’Histoire Naturelle de Paris organisée par Mina Keiche, Joëlle Le Marec et Diego Landivar le 20 février 2023.
[7] Bruno Latour. Changer de société. Refaire de la sociologie. La Découverte, 2006.
[8] John Dewey. The Public and its Problems. Holt, 1927. Voir également Michel Callon, Yannick Barthe et Pierre Lascoumes, Agir dans un monde incertain, Seuil, 2001 pour ce qui concerne la participation des profanes dans les controverses techniques et scientifiques.
[9] Joëlle Le Marec et Ewa Maczek, (dir.) Musées et recherche. Le souci du public. Les dossiers de l’Ocim, 2020 ; Joëlle Le Marec. Essai sur la bibliothèque. Volonté de savoir et monde commun. Presses de l’Enssib, 2021.
[10] Patricia Paperman et Sandra Laugier (dir.), Le souci des autres : éthique et politique du care, Éditions de l’EHESS, 2011.
[11] Jérôme Denis et David Pontille. « Why do maintenance and repair matter? » In The Routledge Companion to Actor-Network Theory, Farias et al., 476 491. Routledge, 2020.
[12] Cf. Miller 2018 op. cité et Le Marec 2021 op. cité.
[13] https://www.louvre.fr/soutenir-le-louvre/le-louvre-remercie-ses-mecenes
Voir également : https://www.greenpeace.fr/action-total-le-louvre-embourbes-dans-la-melasse/ et https://350.org/press-release/350-org-lance-une-campagne-demandant-au-musee-du-louvre-de-mettre-un-terme-a-son-partenariat-avec-total/
[14] Joëlle Le Marec et Hester Du Plessis. Savoirs de la précarité - Knowledge from Precarity. Éditions des Archives Contemporaines, 2020 ; Donna Haraway, Manifeste Cyborg et autres essais. Édité par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Exils, 2007.
[15] Jason W Moore, Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. Verso, 2015.
[16] Anthony Galluzzo. La fabrique du consommateur. Une histoire de la société marchande. La Découverte, 2020. Voir également : Agnès Heller. La théorie des besoins chez Marx. Union générale d’éditions, 1978 et Razmig Keucheyan. Les besoins artificiels. La Découverte, 2019.
[17] J’emploie le mot consommation sans la moindre note péjorative.
[18] Londa Schiebinger, Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World. Harvard University Press, 2004 ; Samir Boumediene, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du « nouveau monde » (1492-1750). Les éditions des mondes à faire, 2019.
[19] Voir par exemple cet article dans Libération sur la programmation inclusive et attentive aux artistes minorisées dans le clubbing : https://www.liberation.fr/lifestyle/anaelle-saas-la-nuit-permet-doublier-le-quotidien-20230208_N32ZRHNUBRH7BNBW5FMMKO74NE/
[20] Une approche qui diverge avec la mini convention pour le climat organisée par le réseau Zones Franches (dédié aux musiques du monde) au printemps 2021 et qui, à ma connaissance, n’incluait pas d’usagers. https://www.zonefranche.com/fr/actus/convention-climat-de-zone-franche.