Le CNMlab – laboratoire d’idées du Centre national de la musique – dévoile sa première publication de recherche de longue durée, une « onde longue » intitulée « Scénarios prospectifs pour orienter la transition (SPOT) ».
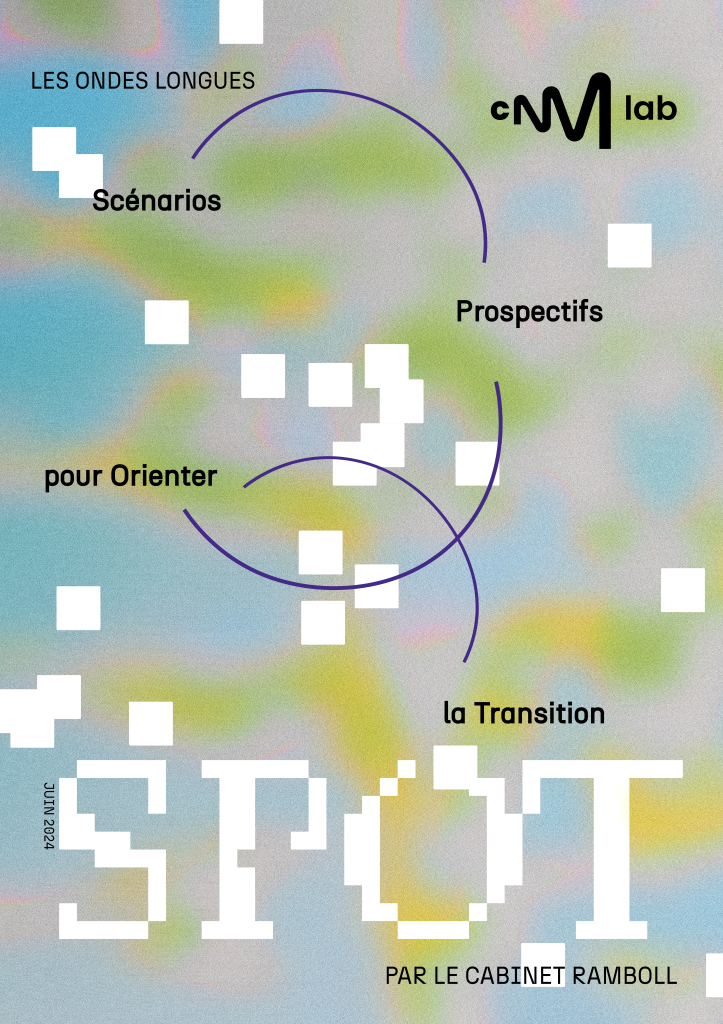
Le CNMlab
Un laboratoire d’idées en relation étroite avec le monde universitaire et académique pour élaborer un programme de recherche complémentaire aux études du CNM.
Pour approfondir sa mission d’observatoire de l’économie et des données de l’ensemble du secteur, le CNM a créé en mars 2022, aux côtés de sa direction des études et de la prospective, le CNMlab. Pensé comme un laboratoire d’idées, le CNMlab a pour rôle d’élaborer un programme de recherche et de publications. Elles portent sur une variété de sujets (modèles économiques, pratiques musicales, diversité, transition écologique, économie numérique, santé, Europe, patrimoine, innovation…), en lien avec l’actualité et les enjeux de la filière musicale. Afin de bâtir un lien étroit avec le monde académique et universitaire, le CNMlab réunit tous les trimestres un conseil scientifique composé d’une vingtaine de personnalités aux profils variés : sociologues, économistes, historiens et historiennes, juristes, musicologues, philosophes… Ce groupe de réflexion consultatif, inédit dans le monde de la musique, vient renforcer le programme de recherche du CNMlab.
Cette étude, inspirée des travaux prospectifs de l’Ademe et menée par le cabinet Ramboll, est le fruit d’une réflexion collective entre la recherche et le monde professionnel pour imaginer 4 scénarios prospectifs, à horizon 2050, pour la transition écologique de la filière musicale.
Dans un contexte de bouleversements climatiques et environnementaux, la filière musicale française fait aujourd’hui face à de nombreux défis : augmentation des risques climatiques et sanitaires, hausse des coûts de l’énergie, vulnérabilité des réseaux de télécommunication aux aléas climatiques, tensions sur les chaînes d’approvisionnement… Une réflexion sur la transition écologique de l’écosystème musical est nécessaire afin de lui permettre d’adopter une logique de développement qui ne dépasse pas les neuf limites planétaires1 définies au niveau international.
Ce développement vertueux passe d’abord par la construction de scénarios visant à dessiner des horizons possibles, à en déduire des objectifs et à faire le nécessaire pour les atteindre. C’est ce qu’a fait, pour l’économie française dans sa globalité, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) avec « Transition(s) 2050 », une projection vers la neutralité carbone en 2050 à travers quatre scénarios prospectifs. Ce travail, couplé aux données de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), a servi de cadre à la construction de cette étude « SPOT » du CNMlab, qui reprend pour la filière musicale les 4 scénarios d’adaptation. Le cabinet Ramboll, spécialisé en prospective, a été mobilisé pour estimer l’impact actuel de la filière, assurer l’organisation du travail prospectif et délivrer le rapport technique final.
Le rapport présente des pistes d’évolution de l’écosystème musical français, à la lumière des enjeux bas-carbone et d’adaptation aux risques climatiques. Il se divise en trois parties.
Un état des lieux de l’écosystème musical face aux défis climatiques et environnementaux
L’étude s’appuie sur une analyse documentaire de données économiques, sur des données issues de bilans carbone existants au dernier trimestre 2023, ainsi que sur une série d’entretiens conduisant à un premier état des lieux de l’exposition de l’écosystème au changement climatique et à ses conséquences. Ce travail a permis d’évaluer de manière synthétique les principaux postes d’émissions, de lister les enjeux climatiques et ceux des ressources biophysiques et non renouvelables pouvant affecter les approvisionnements, les infrastructures, la santé, les conditions de travail, les finances, ainsi que les publics. L’estimation globale qui en découle permet de quantifier les efforts à réaliser pour parvenir à la neutralité carbone dans chaque scénario.
Les scénarios d’adaptation de l’écosystème musical d’ici à 2050
Il s’agit de quatre chemins « types », cohérents et contrastés, conduisant la France, et en l’espèce la filière musicale de notre pays, vers la neutralité carbone en 2050.
- Basé sur le scénario « Génération frugale » de l’Ademe, le scénario 1 est celui de la frugalité ; il est dénommé « A bicyclette » (Yves Montand).
En 2050, l’écosystème musical français n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’il était dans les années 2020 s’inscrivant davantage dans une économie du lien. La politique culturelle de 2050 répond à l’appel de l’urgence climatique par des mesures interventionnistes qui assurent non seulement la diversité et l’inclusion, mais aussi la pérennité de l’art musical dans un cadre respectueux de l’environnement. Les nouvelles régulations ont vu l’émergence d’une scène musicale où l’équité devient la norme. Même si la musique n’a pas de frontières, des différences s’observent toutefois par région en matière de ressources allouées et d’offre culturelle. - Basé sur le scénario « Coopérations territoriales » de l’Ademe, le scénario 2, « Come Together » (The Beatles), est celui de la sobriété et de l’efficacité.
En 2050, tout l’écosystème musical s’est adapté à cette transition progressive qui a permis de garantir l’accès culturel pour tous et toutes et de pérenniser les métiers d’hier malgré quelques ajustements. Le nombre de producteurs de musique enregistrée s’est resserré autour des producteurs historiques. Au prix d’investissements importants, ces acteurs se sont maintenus tout en étant davantage encadrés par les instances culturelles nationales qui les ont poussés à réinventer leur processus de production et de distribution pour s’insérer dans les dynamiques territoriales. - Basé sur le scénario « Technologies vertes » de l’Ademe, le scénario 3, « Computer Love » (Kraftwerk) est également celui de l’efficacité mais en la liant à une plus grande polarisation.
En 2050, l’écosystème musical français reflète les transformations profondes amenées par la transition écologique accélérée et le progrès technologique. Dans cet écosystème, les politiques culturelles ont joué un rôle clé, en engageant des investissements massifs pour soutenir les acteurs et structures qui favorisent les technologies vertes et les pratiques durables dans leur modèle économique et de fonctionnement. Les subventions et les incitations fiscales sont désormais orientées vers les projets qui incluent un volet de réduction de leur empreinte carbone dans le projet qu’ils présentent. - Quant au Scénario 4 « Harder, Better, Faster, Stronger » (Daft Punk), celui des dominations, il est basé sur le scénario de l’Ademe « Paris réparateur ».
En 2050, miroir de cette société, l’écosystème musical français est mis à mal par la convergence de crises sanitaires et sécuritaires et le tournant radical vers la digitalisation. Face aux crises multiples, l’intervention étatique jadis vectrice de l’exception culturelle s’est estompée, l’État a changé ses priorités politiques et a redirigé son attention et ses ressources vers des domaines jugés plus urgents. On a alors assisté à une restructuration des cadres de financement de la culture en faveur d’une approche plus commerciale et centrée sur le privé poursuivant des objectifs de rentabilité plutôt que culturels, favorisant des choix conservateurs ou profitables, au détriment de la création artistique plus audacieuse ou avant-gardiste.
Les principaux enjeux prospectifs face aux défis climatiques et environnementaux
Les scénarios créés dans le cadre de cet exercice ne constituent pas des voies d’évolution ou de transformation qui seraient à privilégier pour l’écosystème musical. Ils suggèrent comment la filière pourrait opérer une mutation, plus ou moins subie, en fonction de différentes combinaisons de facteurs d’influence. Ils offrent ainsi la possibilité de réfléchir aux éléments qu’il serait important d’intégrer dans une vision à long terme de l’écosystème :
- Mieux appréhender « l’écosystème musical » et ses modèles économiques
- Accroître la connaissance, le suivi et l’évaluation de l’action publique dans le domaine de la musique, face aux changements climatiques et environnementaux
- Réduire la fragilité des infrastructures musicales et des publics face aux chocs climatiques en cours et à venir
- Accompagner la mutation des métiers de la musique face à la nouvelle donne socio-environnementale
- Produire, consommer et se déplacer autrement pour l’écosystème musical en lien avec les enjeux bas-carbone et de tensions sur les ressources
- Penser la gouvernance de l’écosystème musical
- Repenser les cadres de gouvernance et de la participation citoyenne dans l’action publique culturelle
- Dessiner le territoire national/régional/local et sa pertinence eu égard aux droits culturels et aux cadres internationaux
- Travailler sur les imaginaires autour de la transformation
- Changer les pratiques et les usages dominants à travers l’expérimentation
- Affirmer le rôle fédérateur et inspirant de la musique pour charger les comportements
Ces scénarios et l’identification de ces enjeux sont la première étape dans l’élaboration, en concertation avec les professionnels, de feuilles de route sectorielles pour des plans d’actions concrets. Ces feuilles de route s’articuleront avec la réforme des dispositifs d’aides financières que le CNM prépare pour la fin de l’année 2024.
[1] Les neuf limites planétaires ont été établies par une équipe internationale de chercheurs, réunie autour du Stockholm Resilience Centre (SRC) en 2009 et reprises en France par le Commissariat général au développement durable (CGDD) : changement climatique, érosion de la biodiversité, perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, changement d’usage des sols, cycle de l’eau douce, introduction d’entités nouvelles dans la biosphère, acidification des océans, appauvrissement de la couche d’ozone, augmentation de la présence d’aérosols dans l’atmosphère.